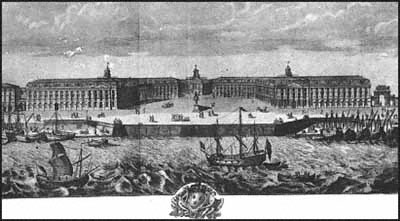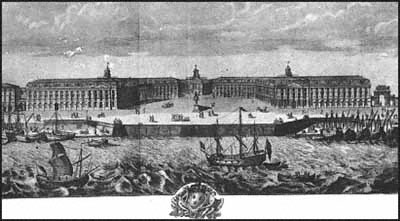

À cette époque tourmentée,
nombreux sont les Français qui songent à délaisser terres et biens pour refaire leur vie là où des
hommes n'ont pas besoin de se piétiner pour posséder un coin de sol bien à eux, même s'il faut le disputer
pied par pied à la forêt. Ils n'en auront pas tous la chance, encore moins le courage. Car il faut beaucoup
de courage pour affronter les périls de la mer! Au bout de six ou sept ans de vie commune, Raymond Pagé et
Madeleine Bergeron (appelée souvent Bergeronne) se sont laissé convaincre; ils tenteront la grande aventure
du pays neuf dont un missionnaire ou un recruteur leur a tant parlé. Et ce missionnaire a pu être le père
Pierre Bailloquet, jésuite de la province de Bordeaux.

De Bordeaux (
voir photo de droite) au Quercy, en remontant la Garonne,
il n'y a pas tellement loin. Il est certain que les Pagé sont arrivés au Canada entre 1646 et 1648,
c'est-à-dire après la naissance d'Étienne et avant celle de Marie, leur deuxième et leur troisième enfant,
Robert l'aîné étant né en France en 1643. Et l'on sait que le Père Bailloquet est débarqué à Québec le 25
juin 1647. Ce fait est signalé dans le Journal des Jésuites : " le 20 juin (1647), est-il écrit, arriva le
premier vaisseau à Tadoussac (
voir photo du bas) et la nouvelle en fut apportée ici le 23, veille de la St-Jean. Ce vaisseau
nous apporta le Père Pierre Bailloquet de la province de Bordeaux et nostre F. Nicolas Faulconier, masson le 25".
Le même vaisseau transportait également le premier cheval importé de France. Les habitants en avaient fait
cadeau au gouverneur.

Le nouveau missionnaire et la famille
Pagé se seraient embarqués ensemble à La Rochelle et auraient traversé l'Atlantique sur le même vaisseau.


La Guyenne n'a peut-être pas contribué
au peuplement de la Nouvelle-France dans la même mesure que la Normandie, la Saintonge ou l'Île-de-France,
mais elle a délégué une gerbe de colons de qualité, tels que Raymond Pagé de Quercy et ses fils.

Né vers 1604, Raymond Pagé a déjà
dépassé le cap de la quarantaine lorsqu'il débarque à Québec avec sa femme et ses fils Robert et Étienne.
S'il a évité les affrontements de la Fronde, qui ne se produiront qu'à partir de 1648, il n'arrive pas non
plus dans une période de tout repos.
Dans sa relation de 1647 (Relations des Jésuites, tome 4, Éditions du Jour)
le père Jérôme Lalemant, supérieur des missions de la Compagnie de Jésus au Canada, décrit le travail des
missionnaires auprès des nations indigènes et note que les Iroquois sont toujours aux aguets sur les rives
du fleuve, " découvrant de loin les vaisseaux et leurs nochers pour les surprendre ou pour les combattre
s'ils sont en petit nombre ".

Voilà pour la grande aventure!